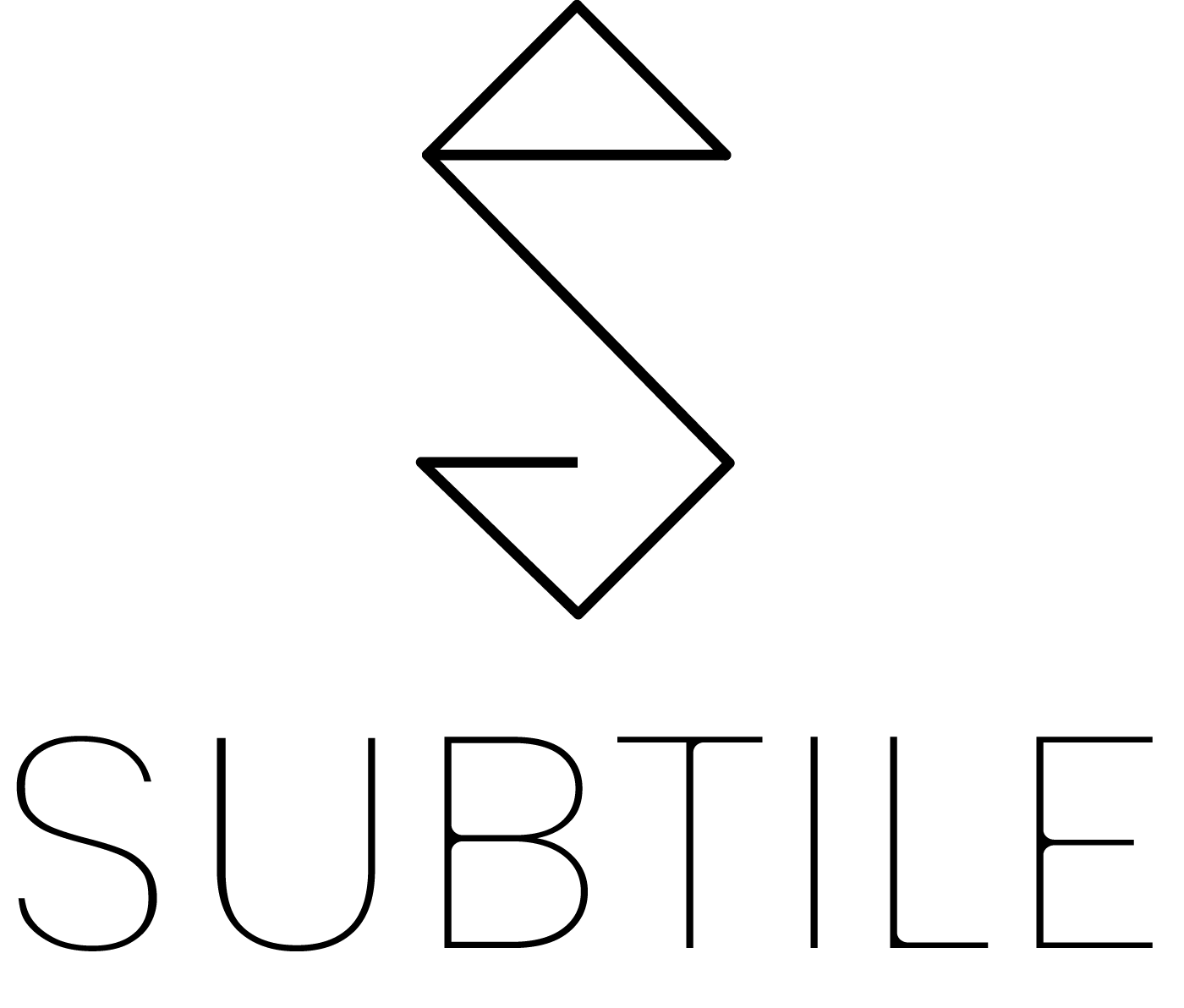Serge Aimé Coulibaly : “Mon travail, c’est le rêve.”
“Mon travail, c’est le rêve.”
- Serge Aimé Coulibaly
J'aimerais savoir ce qui t'a amené à faire la danse comme activité artistique.
C'est la danse qui est venue à moi. Je voulais faire du théâtre. Moi je voulais devenir comédien. Je suis entré dans une compagnie ici au Burkina Faso, la Compagnie Feren, qui était professionnelle. Sauf que là le mot théâtre voulait dire chant, danse, etc On travaillait six jours sur sept, toute l'année, sans vacances, de 7 à 10h, de 10h30 à 12h30, on devait avoir un projet qu'on devait développer. De 15h à 17h30, on répétait. De 17h à 21 h, c'était la création d'une pièce de théâtre.
J'excellais en danse. Je suis devenu le responsable en danse de cette compagnie et aussi le chorégraphe.
Quel type de danse tu faisais dans cette compagnie ?
J'ai envie de dire que je faisais de la danse de création. On n'avait pas à proprement parler de danse précise. Dès qu'un savait danser, il nous faisait un stage que ce soit du classique, du traditionnel, du hip hop et nous apprenait quelque chose. Moi-même je partais regarder les danses des troupes traditionnelles et je les apprenais à mes camarades. On voulait juste danser.
Tu viens de dire que vous vouliez juste danser. Tu les changeais un peu ces danses ? Tu les apprenais aux autres ? Quand tu les changeais, quel processus était le processus pour toi ?
Je crois qu'à la longue on finit par trouver des mots pour dire les choses simplement, sans se poser de questions. Je me disais que je voulais voir ce que c’était de faire du nouveau à partir de l'ancien. Je prenais un pas de danse, je ne voulais pas qu'on le reconnaisse exactement. C'était la création à partir d'un pas traditionnel, par la mémoire pas par la pratique réelle.
Quelle est la différence entre celui qui est chorégraphe et celui qui est interprète ?
Tu poses des questions qu'on ne m'avait jamais posées. C'est une grosse différence. L’interprète ou le chorégraphe, le danseur et l'artiste. L'artiste crée, transforme quelque chose qui n'existait pas. Parlons du chorégraphe, le créateur qui a un grand concept, qui a envie de partager cette chose-là avec un monde. La danse, c'est un vecteur. Tu as le concept. Ce que tu as envie de dire et tu crois être le seul à le dire de cette manière-là. Là où il y a un vrai problème, c'est que tout danseur pense qu'il est forcément chorégraphe. Chorégraphe, c'est une vision, une manière de voir le monde. On veut travailler cette façon de voir le monde-là sur scène ou ailleurs. Le danseur est censé faire des figures, des images avec son corps pour qu'il puisse l'amener quelque part. Même si aujourd'hui par exemple un danseur, un vrai interprète, c'est celui qui crée. C'est fini le temps où on s'assoit tac tac tac tac, on fait tel pas. C'est très réducteur. On n'utilise pas le danseur dans sa totalité.
Alors dans ton travail d'écriture chorégraphique, dans ce que j'ai vu, on sent qu'il y a une grande réflexion avant d'arriver à ce que nous voyons. J'ai envie de dire que tu es un chorégraphe intello et c'est une approche qui me touche beaucoup. Est-ce que dans ce que tu crées, il une notion d’activisme ? Est-ce un acte de résistance ?
Absolument. C'est un acte de résistance. D'abord une création pour moi c'est comme une thèse. Je fais énormément de recherches. J'ai envie d'être imbattable sur le sujet que je suis en train de traiter si on me pose une question et que je ne peux pas y répondre. Si je prends un spectacle comme Kalakuta, depuis 2014. Si je prends Fela Ransome Kuti, c'est énormément de questionnements par rapport à l'homme. Je prends seulement deux ans pour m'y préparer. Pour Nuits blanches à Ouagadougou, j’ai pris deux ans pour me rapprocher du sujet. Je rassemble des images, des livres, des magazines. Je ne connais pas un jour où je me suis assis sans rien faire. Donc par exemple devant mon ordinateur je tape le titre pour voir s'il n'est pas déjà utilisé. Une nuit de création, de violence sur soi. Avant vers 2005, dans mon cahier j'avais des coupures de presse avec des vues d'émigrés qui sont à Melilla. Pour Kalakuta Republic en plus de faire l'intégrale de sa musique, à la fin, plus personne ne voulait entendre parler de Fela dans mon entourage. Sur un plateau avec des danseurs je fabrique des choses parce que je suis imprégné de beaucoup d’influences depuis longtemps.
Ça se sent vraiment que c'est l'aboutissement de toute une recherche quand on voit le résultat. En sortant du spectacle j'avais des tableaux précis en tête. Les différents personnages, un Mad Max à l'africaine…
C'est la troisième création que je fais avec des marques sur le corps. Ça n'avait rien à voir avec Fela au départ. J'ai accumulé de la documentation. Le futur m'intrigue. Mon travail, c'est le rêve. On a besoin de faire sortir les gens, de les bousculer, de les faire rêver en leur proposant quelque chose. Ça dérange le cerveau pour aller voir ailleurs. Je dis souvent aux gens comment l'Amérique est arrivée à nous plonger dans un rêve. La première fois que je suis arrivé à Los Angeles, j'étais choqué. Les gens dorment dans la rue, tu as des saletés jetées çà et là, des poubelles, des trains taggés de partout, un bout d'immeuble au milieu de tout ça. Et tu as les villas des stars de Beverly Hills. C'est un film américain. Ce petit bout d'immeuble, on va te le survoler et l'agrandir, tu as l'impression que c'est un rêve.
On a besoin de bousculer le reste du monde par rapport à la vision qu'ils ont de nous. Parce qu'en fait cette vision elle est restée bloquée depuis 40-50 ans. Si je repars avec ces idées de peintures sur le corps c'est un prétexte, quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai vu des artistes dont un qui travaillait avec moi. Il écrit au tableau « L'Afrique nous apporte la chaleur ». Et il dessine une case. Je lui demande qui parmi nous ici habite une case ? Aucun. Pourquoi donner cette image de la case aux regards extérieurs ? Fantasmes.