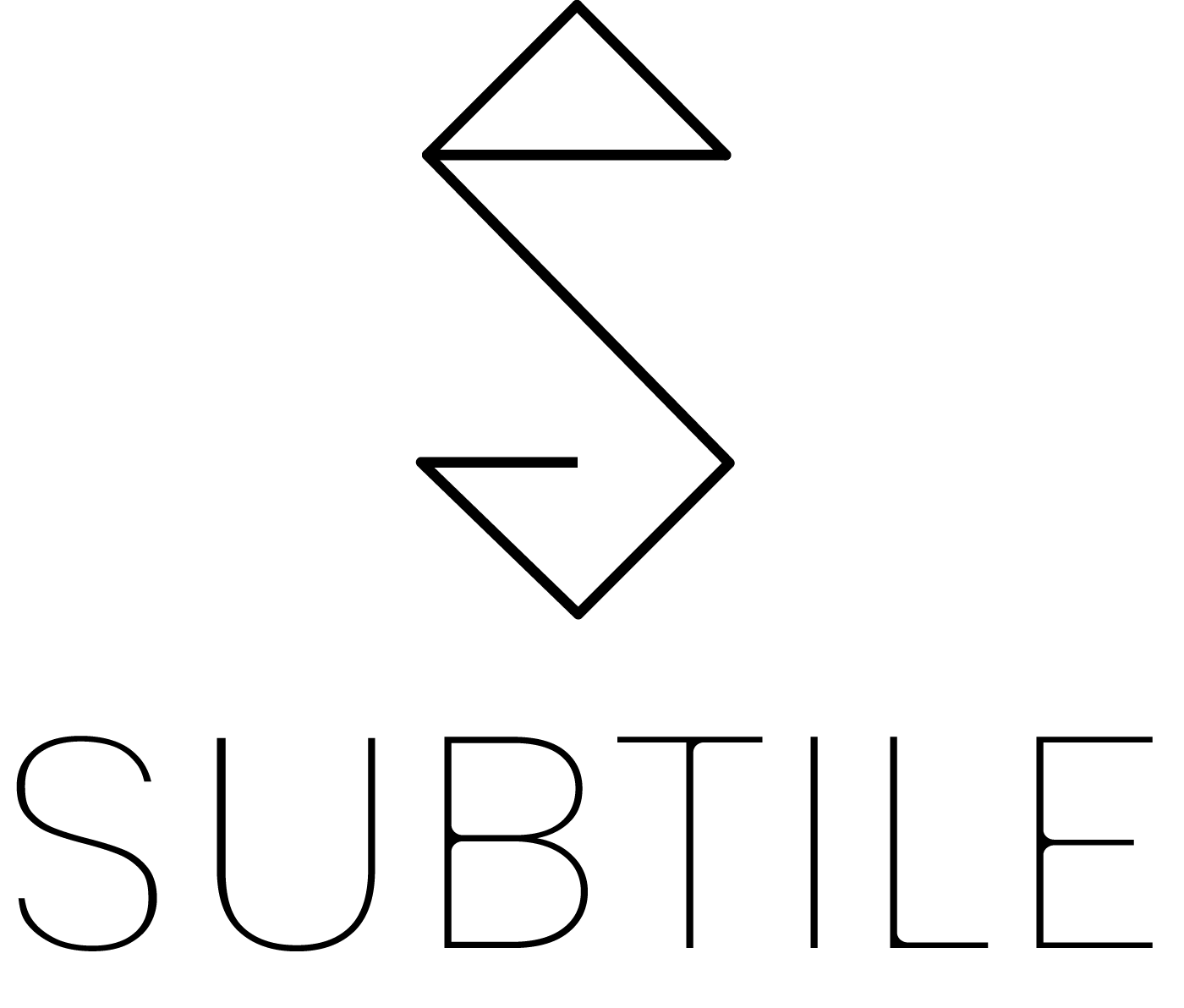Maboula Soumahoro, Ma notoriété relève du devoir
Maboula Soumahoro,
« Ma notoriété relève du devoir et non du plaisir »
Elle aime Björk, le reggae, le rap, la musique des Caraïbes. Elle affectionne particulièrement Maryse Condé mais aussi Édouard Glissant ou Virginia Woolf pour ne citer qu’eux. Les Amériques la fascine… Maîtresse de conférences, Maboula Soumahoro est une civilisationniste du monde anglophone. Elle donne cours aux États-Unis et en France, à Tours, où elle enseigne à l’université. Au cours de ces 15 dernières années, la spécialiste s’est intéressée aux communautés afro-américaines des USA et à la diaspora africaine.
Plus récemment, aux populations noires européennes, comme en témoigne sa participation à un colloque universitaire qui se tenait pour la première fois en Europe, à Séville. Une occasion de rappeler que l’Espagne et le Portugal ont été les premiers pays foulés par les esclaves africains. L’enseignante-chercheuse d’origine ivoirienne aime mener les choses à bien. Elle se dit quelqu’un de déterminé. Sa voix la traduit fidèlement d’ailleurs. Sollicitée par les médias, Maboula Soumahoro empoigne les sujets « sous-traités » et se fait porte-voix. Cette position est souvent perçue comme militante et pourtant, il y a des mots comme ça qu’elle éviterait volontiers ! Dans les écoles, prisons, cinémas, maisons de quartier ou plateaux télé, ses interventions sont diverses. La chercheuse y a trouvé et gagné sa place. Cet entretien a été réalisé en 2018, en 2020 Maboula Soumahoro a publié un récit autobiographique: Le Triangle et l’Hexagone aux éditions La Découverte.
Comment décririez-vous le monde de la recherche pour une femme ?
On retrouve davantage les femmes-chercheuses en lettres, langues et sciences humaines, elles sont peu représentées en sciences dures. Et même si la profession de maître de conférences se féminise, les femmes sont moins présentes lorsque le nombre d’années d’études est élevé. Les hommes en couple sont très soutenus par leurs conjointes dans leur thèse ou début de carrière, le contraire n’est pas aussi évident. Il y a beaucoup de femmes célibataires ou qui font des sacrifices énormes si elles ont pour idée de poursuivre cette carrière. Mon entourage m’a soutenue mais rétrospectivement, je pense que je n’aurais pas poursuivi mon doctorat si je n’avais pas été célibataire. Aujourd’hui je ne suis pas mariée et je n’ai pas d’enfants.
Quels autres freins avez-vous connus ?
Ils étaient liés à la question sociale puisque je viens d’un milieu extrêmement modeste, et raciale, en tant que femme noire. « Est-ce bien vous la professeure ? L’organisatrice du colloque ? », etc. Il est toujours question de légitimité. Etre pauvre et faire des études supérieures implique de travailler, d’autant que je n’avais pas de bourse doctorale. J’ai fait de nombreux petits boulots. J’avais peur de la réussite, ou de trop réussir. Lorsqu’on est un transfuge social et qu’on passe d’une classe sociale à une autre, il peut y avoir beaucoup de culpabilité et un syndrome de l’imposture. Ce sont des freins qu’on se met à soi-même. Aujourd’hui c’est très différent ! Le combat a changé, il s’agit de faire accepter ma légitimité. Car les freins sociétaux sont réels. Ma légitimité peut être remise en cause mais moi j’ai gagné en assurance.
Vous avez pourtant acquis une notoriété !
Cela peut paraître étrange mais je ne l’ai pas cherchée. Les invitations aux émissions me sont tombées dessus. Mon objectif était d’obtenir un diplôme, enseigner et voyager. J’ai passé une partie de ma vie aux États-Unis et mené toute une réflexion sur ma trajectoire personnelle, familiale, et sur des questions sociales ; à mon retour en France, j’ai commencé à être sollicitée pour participer au débat public. Je m’intéressais déjà aux questions de justice sociale. Quand j’interviens dans la sphère publique c’est pour dire quelque chose depuis mon parcours et depuis mon identité noire. Je souhaite normaliser un certain discours, ma présence et celle de personnes qui me ressemblent. En tout cas, cette notoriété, c’est du travail pour moi, cela relève du devoir et non du plaisir. Je pourrais être anonyme et très bien le vivre.
Sur quoi portaient vos dernières interventions dans les médias ?
En juin, on a fait un tour de l’actualité avec d’autres intervenants sur LCI. Nous avons évoqué un réfugié irakien soupçonné d’être un cadre de Daesh : comment avait-il fait pour entrer en France ? Quid de l'accueil des migrants ? On a aussi parlé du G7, du revenu universel et de la hausse de la TVA pour les restaurateurs.
Quelle est votre opinion sur le revenu universel ?
Je suis tout à fait pour mais je ne suis pas politicienne. Ce qui m'intéressait dans la discussion c'est qu'il y a débat autour des riches et des pauvres, des assistés et des non assistés, des travailleurs et des feignants, de la fraude. Pour moi le terme assistanat c'est comme le terme communautarisme, ce sont des mots dangereux. L'assistanat je ne sais pas ce que c'est. J'ai le sentiment qu'on s'intéresse toujours à une minorité qui profiterait du système, alors que dans leur grande majorité, les pauvres sont des personnes qui triment et essaient de vivre. On ne peut pas vendre du rêve, expliquer aux citoyens que s’ils ne consomment pas et n’ont pas d'argent ce ne sont presque pas des êtres humains, et ensuite accepter que certaines personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté ou dans la précarité la plus extrême. Notre société fabrique des travailleurs pauvres qui ne gagneront jamais assez pour pouvoir vivre de manière décente ou profiter de ce qu’est censé offrir notre société de consommation. Dans ce cadre-là, des mots comme « assistanat » me dérangent toujours.
Cela fait écho au « pognon de dingue », expression d’Emmanuel Macron pour parler du budget que la France consacrerait aux minima sociaux…
Bien sûr que cela coûte cher de s’occuper de personnes qui n'ont pas d'argent mais je pense que cela coûte encore plus cher d'être pauvre. Nos sociétés sont injustes et c’est un fait. Il y a des riches parce qu'il y a des pauvres.
Vous participez parfois à des débats très tendus. Sur Internet, d’aucuns vous accuse de racisme communautariste ou racisme anti-blanc. Que répondez-vous ?
Ce sont des notions qui n’existent pas donc il n’y a pas à débattre. Je trouve ça arrogant, scandaleux et complètement hypocrite d’utiliser ces termes dans une société où on continue à dire que les races n'existent pas, que les identités raciales n'ont aucun sens. Je sais qu’on m’accuse de plein de choses. Mon propos est toujours le propos minoritaire, ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas raciste et ces débats montrent une fois encore l'ignorance et le manque de culture quant à cette question du racisme. On tourne en rond. Le racisme c’est un système, ce n’est pas insulter ou agresser quelqu’un, ce n’est pas une situation individuelle. Un blanc qui ne se sentirait pas bien dans son quartier ce n’est pas comparable au fait de ne pas obtenir de diplôme, de ne pas avoir une position socio-économique confortable, ne pas se faire soigner correctement ou se loger dignement. Les personnes qui utilisent toute cette terminologie n’ont pas étudié la question ; la pensée raciste c’est justement mon expertise.
Avez-vous déjà subi des menaces ?
Généralement on m’intime de me taire, de retourner dans mon pays, ce sont des insultes, des lettres anonymes pour m'indiquer qu'on sait où j'habite, des appels téléphoniques. Au début cela m’affectait, il m’est arrivé d’avoir peur. Mais je ne lis pas les commentaires sur les réseaux sociaux et je comprends que ce que je dis puisse ne pas être plaisant à entendre.
C’est quoi pour vous être une femme noire en France ?
Un des paradoxes les plus étranges : être à la fois hyper-visible (on est noires et cela se voit), et complètement invisible. Il y a une totale invisibilisation dans la sphère publique. C’est faire partie d’une hiérarchie défavorable qui peut être la base de discriminations et d’exclusion. Il y a des postes et des lieux où on vous attend et d’autres où on ne vous attend pas. Ça c’est réel. Il y a un imaginaire construit autour de cette identité noire : il est difficile d’envisager une patronne, une docteure noire. Le seul CDI qu’on m’a proposé c’était pour être gardienne d’immeuble ! Si je devais donner un conseil aux nouvelles générations de femmes noires ce serait de trouver des façons d’obtenir ce qu’elles veulent, de ne pas transiger et de rester libres.
Sur vos biographies, il est dit que vous vous considérez comme afropéenne. Qu’est-ce que cela signifie ?
C’est plutôt quelqu’un qui l’a dit de moi ! En France, on a un problème lexical et un tabou énorme sur la race et les identités raciales. Il y a plein de mots et d’expériences que nous ne savons pas dire et décrire. Mais il y a un effort fait depuis quelques années. L’identité afropéenne a été popularisée (et non inventée) par l’écrivaine Leonora Miano dans ses romans et ses essais. Le groupe belge Zap Mama l’utilisait déjà dans les années 90. La manière dont je comprends le terme c’est parler des populations noires indigènes à l’Europe : qui sont nées en Europe et qui sont noires. En France, l’identité noire est toujours vue sous l’angle de l’immigration, sauf que je suis née à Paris, j’ai grandi en France, je ne suis pas immigrée. C’est intéressant de voir comment la France s’accroche à cette identité d’immigré. C'est comme s'il y avait une impossibilité à ancrer les gens comme moi dans le territoire français.
Pourquoi selon vous ?
Parce que la France a du mal à regarder en face son histoire. On parle des problèmes liés à l'intégration et à l'assimilation récente (ces 40 dernières années) comme s’ils étaient tombés du ciel. Comme si ces personnes étaient venues ici par hasard. Alors que si on s’intéresse à l'histoire de la France, on s'aperçoit que toutes ces populations sont en relation avec elle depuis des siècles. Ça nous emmène immédiatement à l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. Ces vagues migratoires s'expliquent ; mes parents font partie de cette immigration postcoloniale.
Et quel est votre regard sur l’accueil des migrants en France aujourd’hui ?
On ne peut pas mener une politique étrangère trouble et s’étonner ensuite des conséquences de cette politique. Bien sûr que la France a une responsabilité ; on parle de populations qui se déplacent, qui essaient de quitter des pays instables politiquement et qui sont déstabilisés par le rôle joué par les grandes puissances actuelles et dont la France fait partie. Il faudrait arrêter de jouer un rôle dans la déstabilisation de ces pays.
Vous avez soutenu votre thèse il y a 10 ans. Quels ont été les grandes satisfactions de votre vie et de votre carrière ?
Ma soutenance justement. La création de l’association Black history month. Et les cours que j’ai pu suivre aux États-Unis, les professeurs que j’ai rencontrés, les conférences auxquelles j’ai pu assister. Ils ont vraiment été une ouverture sur le monde que je n’ai jamais connue en France. Aujourd’hui je continue à enseigner là-bas. Je pense que je suis assez tiraillée car le contenu de mon enseignement est plus important pour la France que pour les États-Unis. Un travail a déjà été fait là-bas, des victoires ont été obtenues et en France pas encore. Aux États-Unis je peux travailler au sein de départements qui sont établis alors qu'en France on a l'impression que tout est à construire.
Pour finir, quelles sont les actions de Black history month ?
Elle met en œuvre une série d’événements culturels qui tourne autour de l’histoire et des cultures du monde noir et de la diaspora. Son nom fait référence à un événement qui existe déjà aux États-Unis. Le but était de rendre hommage à cette histoire afro-américaine et aussi de mettre un coup de projecteur sur la France car ici on a parfois l'impression d'être inféodé à l'histoire afro-américaine. Il s’agit d’apporter une offre culturelle de qualité, grand public et gratuite, autour de questions qui sont ignorées ou très mal connues. Le monde noir est vaste et riche.
Propos recueillis par Emilie Drugeon.
Photos par Patricia Khan